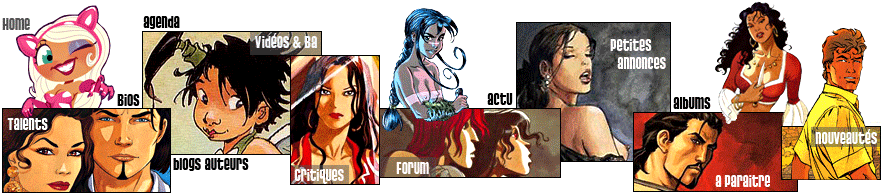Un homme est mort par Philippe Belhache 

"Un homme est mort", de Kris et Davodeau. Futuropolis.
Un mouvement social, une victime innocente, un cinéaste engagé, un film disparu... L'écrivain Didier Daeninckx en aurait fait un polar, revisitant la mémoire sociale pour interroger les consciences, mettre en lumière les pans d'ombre de l'Histoire, la réécrire du point de vue de ceux qui ne sont jamais apparus dans les manuels. "Un homme est mort" procède de la même démarche, même si Kris et Davodeau ont écarté l'hypothèse de la fiction pour se fixer sur le réel, une véritable aventure humaine. Celle de René Vautier, cinéaste engagé mandaté par la CGT pour tourner un documentaire dans la tourmente des mouvements ouvriers de 1950, avec pour toile de fond le chantier de reconstruction de Brest, cité mise à genoux par la Seconde Guerre mondiale. Ce récit développé par le scénariste breton Kris, au demeurant diplômé d'histoire, ne pouvait que séduire Etienne Davodeau, auteur plusieurs fois primé l'an passé pour "Les mauvaises gens" (Delcourt).
Les deux hommes se sont attaché à une reconstitution aussi minutieuse que sensible du parcours de Vautier dans le chantier, prenant pour point de départ la mort d'Edouard Mazé, fauché par une balle en pleine manifestation ouvrière. Ils suivent pas à pas le futur réalisateur de "Avoir 20 ans dans les Aurès" (Grand prix de la critique internationale à Cannes en 1972), ancien étudiant de l'IDHEC alors âgé de 23 ans et déjà recherché pour avoir filmé la répression de la grève des mineurs dans l'immédiat après-guerre. La découverte d'une ville en perte d'identité, le tournage du film dans des conditions précaires, le montage effectué avec des bouts de ficelles, la projection renouvelée soir après soir comme un nouvel exploit... Et en toile de fond, omniprésent, le poème de Paul Eluard "Au rendez-vous allemand", rédigé à l'origine en hommage au résistant Gabriel Péri, adapté sur mesure à la mémoire d'Edouard Mazé. Remontant ainsi le temps, Kris et Davodeau sacrifient à un devoir de mémoire militant. Le film lui-même, dont l'unique copie réalisée avec des bouts de ficelle - "le système Vautier - Afrique 50" - n'a pas résisté aux multiples représentations nocturnes sur les chantiers de Brest.
En tête de l'ouvrage, Kris a fait figurer une citation extraite de l'ouvrage d'Howard Zinn, "Une histoire populaire des Etats-Uni" (Ed. Agone). Un choix qui n'a rien d'anodin. Ce professeur émérite de l'université de Boston bientôt octogénaire, militant de la première heure pour l'égalité raciale aux Etats-Unis, profondément impliqué dans la lutte contre la guerre au Vietnam comme en Irak, a fondé sa démarche sur la ré-écriture de l'histoire des Etats Unis du point de vue de ses populations et non plus de ses élites. Kris et Davodeau ne font rien d'autre, épousant ainsi le point de vue de René Vautier, déniant au pouvoir alors en place le pouvoir d'imposer un seul point de vue, de contrôler le droit à l'image.
Le graphisme rond d'Etienne Davodeau, fait merveille dans l'évocation de cette période troublée, véhiculant la violence et l'énergie, la détermination comme l'abattement. L'homme fait la part de l'historique et de l'interprétation, privilégiant l'émotion sans s'embourber dans le piège d'une reconstitution visuelle trop pointue. Il s'ouvre ainsi au témoignage, traduisant la mobilisation, mais aussi le désarroi d'ouvriers réunis face à une machine gigantesque et sans états d'âme, à des policiers qui ont tiré sur ordre à balles réelles. Il franchit ainsi, avec un regard engagé mais lucide, une nouvelle étape dans ce domaine encore en friche qu'est le documentaire en bande dessinée, sillon inégalement creusé depuis Art Spiegelman, avec des regards aussi différents et complémentaires que ceux de Joe Sacco ou Philippe Squarzoni.